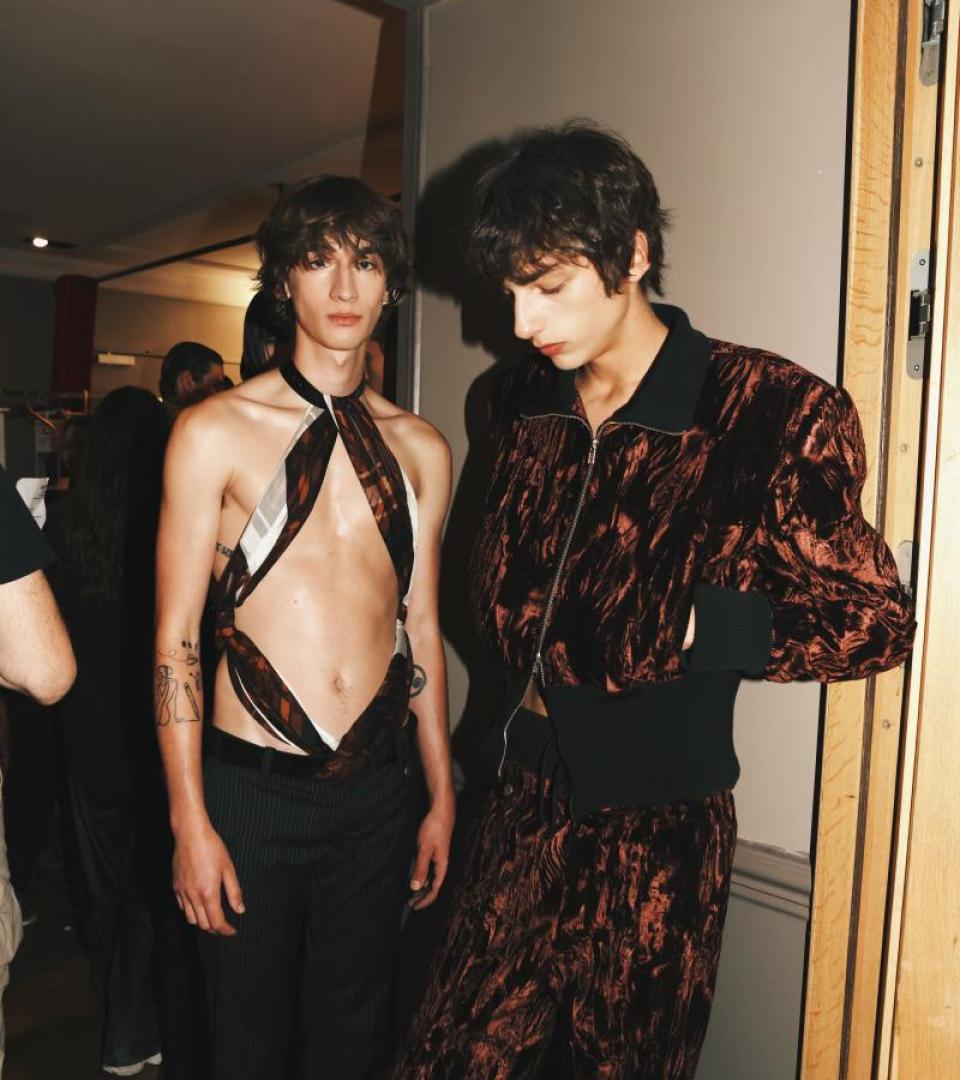Olivier Saillard : "J'aime ce que la mode a d'éteinte, d'enfouie. Les vêtements que l'on choisit de porter nous guident et nous racontent."
C'est l'histoire d'un petit garçon, blotti contre des vêtements entassés dans un grenier, devenu notamment dirigeant du Palais Galliera puis de la Fondation Azzedine Alaïa. Il a signé près de 250 expositions, des dizaines d'ouvrages et une trentaine de performances, dont "Moda Povera V – Les vêtements de Renée", qu'il présente au Grand Palais du 10 au 13 juillet. Un hommage à ces mêmes vêtements protecteurs de son enfance : démonstration saisissante que la mode porte l'empreinte du vivant, de la mémoire et de l'intime.
Dans son bureau à la Fondation Alaïa, qu'il dirige depuis 2017, les étagères débordent de livres, des livres, beaucoup de livres. Des livres de mode, ou d'art, des deux mélangés. Et lui-même est un sacré mélange, de douceur et de précision. Quelques quêtes obstinées traversent son parcours : le mot juste, la poésie des vêtements du passé, ou encore Madame Grès, qu'il ne peut pas s'empêcher de mettre en lumière dès qu'il en a l'occasion. Le plus frappant chez ce grand travailleur, c’est qu’il a gardé intacte cette faculté d’émerveillement propre à l’enfance. Faites référence à un créateur qu'il admire et il s'anime. Cet émerveillement, il l'a partagé dans ses très nombreux projets – expositions, livres, performances – partout où on lui a confié les rênes. Au Musée de la Mode de Marseille qu'il a dirigé dès ses 27 ans et où il a signé "L'homme-objet", première exposition dédiée à la mode masculine. Au Musée des Arts Décoratifs, où il a consacré Yamamoto, Balenciaga, Lacroix. Au Palais Galliera, où il a notamment célébré le talent de sculptrice de Madame Grès. Aujourd'hui, il est à la fois "directeur artistique, image et culture" du bottier Weston – qui de plus pertinent que l'historien de mode pour piloter une Maison au patrimoine monumental ? - et directeur de la Fondation Alaïa. Il y scrute le travail du grand couturier avec la culture d'un commissaire, la rigueur d'un archéologue et la loyauté d'un proche. Un parcours remarquable qui s'est construit naturellement. Il y en a bien un qui l'avait pressenti très tôt : "À 18 ans, j'avais envoyé mes dessins à Christian Lacroix. Je voulais faire de l'illustration de mode, mais j'étais autodidacte. De sa belle écriture, il m'avait répondu qu'avec cette passion-là, j'allais faire de la mode. Il avait conclu par 'Ce qui doit vous arriver arrivera'. Ça m'a porté." Christian Lacroix, prophète qui montre la voie, mais ça on le savait tous un peu déjà.
"Je trouvais qu'on n'avait pas inventé le musée de mode qu'on avait le droit d'avoir, et qu'on allait essayer."
Lorsqu'Olivier Saillard débute les performances il y a vingt ans, c'est avec l'objectif "d'introduire du vivant dans les musées". En 2005, avant même de prendre la direction du Palais Galliera, il signe sa toute première performance "avec une amie, Violeta Sanchez, qui était mannequin pour Saint Laurent." Il présente alors pour la première fois, pour lui comme pour les autres, un défilé de mots. "Elle décrivait des vêtements, comme on le faisait dans les salons de couture, mais il n'y avait pas de robes." Ainsi naissent les prémices de la série "Moda Povera", qu'il lance en 2018. La référence est évidente, l'arte povera, courant artistique italien des années 1960 qui prônait un recours à la simplicité des matériaux et des techniques, en impliquant le spectateur au sein de l'œuvre. Une façon pour lui de revenir au cœur de ce qu'est la mode : le savoir-faire et la confection d'émotions. Cette nouvelle série débute avec Martine Lenoir et Axelle Doué, toutes deux ayant travaillé chez Madame Grès, comme couturière et comme mannequin cabine. Ensemble, ils détournent des t-shirts trouvés sur internet – "certains t-shirts coûtaient moins cher que leurs frais de livraison." - en les sculptant de draperies, de découpes et de coutures. "Je me suis dit que Moda Povera allait être une entreprise où on fait se rencontrer des gens, des anciennes couturières qui ont fait partie d'ateliers, des couturières de quartiers, des gens plus jeunes, et ça a continué." Après les t-shirts, il s'attaque "aux costumes d'homme Kiabi, puis aux chemises. J'ai pris goût à faire ces vêtements, à les transformer. Je trouve que c'est aussi faire de l'histoire de mode."
"Avec Moda Povera V, c'est devenu évident qu'il n'y avait rien à vendre dans mes performances. Il n'y a qu'une entreprise pédagogique, une entreprise collective d'histoire, d'histoire intime."
Cette entreprise poétique culmine lors de son cinquième chapitre : "Les vêtements de Renée". Il aurait pu l'intituler "Les vêtements de ma mère" mais cela aurait pu la réduire à sa fonction maternelle. L'appeler par son prénom lui rend sa totalité. Et c'est précisément ce que font nos vêtements, ils nous racontent. "Si on ouvrait chacun nos armoires, on aurait de quoi raconter qui nous sommes. J'ai souvent pensé que les vêtements rangés sont comme des livres sur une étagère, sur la tranche. J'aime ce que la mode a d'éteinte, d'enfouie. Même en mettant nos vêtements par hasard, ils nous guident, ils parlent de nous."
Celui qui a voué sa vie à archiver les pièces du passé se retrouve face à sa propre histoire. "Ma mère est décédée en 2020, pendant le Covid, pas du Covid. J'avais du mal à remettre le nez dans ses vêtements. Je trouve très dur, presque plus dur encore que la mort, de nettoyer le passé." À l'instinct, il vide les cartons, redécouvre sa mère à travers sa garde-robe. "Il y avait 40 pantalons noirs, je ne sais pas pourquoi. Elle était rousse et il y avait aussi des couleurs comme le mauve, le vert, qui vont particulièrement bien." Certaines pièces retiennent plus son attention, parce qu'elles sont des témoins de mémoire, comme "cette robe Daniel Hechter qu'elle avait acheté pour le mariage de ma sœur." Il trouve des manteaux et décide d'en faire des capes. "Je regardais beaucoup les capes de Schiaparelli et de Charles James. Donc, on a enlevé les manches de tous les manteaux. Comme si on avait supprimé des ailes. Il y a dans les vêtements transformés une forme de plongée dans le silence."
Ces mêmes vêtements, il s'y blottissait déjà enfant. "On rangeait dans le grenier les vêtements qu’on ne portait plus, comme des robes des années 50 de ma mère qu’elle ne mettait plus en 70. Quand on est gamin, 20 ans avant ça parait aussi éloigné que le XVIIIe siècle. Passer du temps dans ce grenier quand j'étais enfant m'a dicté le goût de l'avant. J'aimais bien cette poésie." Parfois, il se prenait même à tout vider, à exposer les vêtements, jusqu'à en créer une masse informe pour s'y confondre. "Ma mère criait qu'elle avait tout rangé. Je me roulais dans les vêtements du passé." C'est sûrement là où tout s'est noué, l'urgence de mettre en scène le vêtement comme un vecteur de mémoire et d'émotion où l'on peut se réfugier. "Je repense aux installations de Christian Boltanski, avec ces montagnes de vêtements. Ça prenait une charge beaucoup plus symbolique et effrayante. C'est la mort identifiée. Je trouvais que j'étais plus proche de ça, dans mon goût naturel."
En replongeant dans ces cartons, il retrouve notamment un exemplaire d'une revue de mode, "Le Grand Couturier", qu'il avait confectionné lui-même lorsqu'il avait 12 ans. Il avait rédigé les articles, griffoné des collections. "J'avais fait un dessin pour expliquer comment faire un défilé. J'avais fait le podium, dessiné un pseudo-mannequin et précisé le nombre de pas, la pose au bout du podium, comme une fiche technique." Il signe tous ces articles de son prénom et invente différents noms de famille, un pied dans la fiction, l'autre dans la réalité. "Ca me rassurait qu'il y ait écrit Olivier et ça me rassurait qu'il y ait différents noms."
"Je fais toujours en sorte de pouvoir faire sans que l'économie ne préexiste aux choses. Je voudrais toujours être comme un écrivain qui, même sans ordinateur, a toujours son carnet et son stylo pour travailler. Il faut que je puisse faire, quels que soient mes moyens."
Au Grand Palais, il co-signe sa performance avec Axelle Doué , Zoé Guedard et Gaël Mamine. "Ce que j'aime dans Moda Povera, c'est ce système de création collective qu'il y a dans la danse contemporaine. C'est de la création collective. Je serai incapable de transformer des vêtements sans Axelle. C'est en voyant la pièce sur elle, sa façon de bouger, que les choses prennent. Gaël Mamine est mon compagnon depuis 29 ans, et Zoé Guedard était en stage avec moi au Palais Galliera et m'a suivi chez Weston. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Avec Nathalie Ours nous partagons travail et enthousiasme depuis 20 ans." Des relations de longue date et une complicité forte qui servent nécessairement l'intimité du thème abordé. "C'est vrai que ce ne sont que des histoires longues. Je n'ai que des gens que je connais depuis longtemps autour de moi."
Cette fidélité aux collaborations au long cours, Olivier Saillard l'a aussi cultivée avec l'exceptionnelle Tilda Swinton, si fascinante qu'il peut sembler risible de la ranger sous la simple catégorie d'actrice britannique oscarisée. "Avec Tilda, on a d'abord fait une performance ensemble il y a 13 ans, sans savoir que ça allait continuer. On est devenu amis, très proches." Et c'est précisément cette grande proximité qui permet de dialoguer sans mots, plus librement. "Lorsqu'on jouait "Embodying Pasolini" en Pologne récemment, elle plaisantait parfois au creux de mon oreille. Nous ne sommes pas gouvernés par l'exactitude. Nous n'avons pas de partition." Et leur collaboration se poursuit toujours, dès septembre prochain à Amsterdam. Tilda Swinton a invité huit artistes et amis à revisiter sa carrière de quatre décennies : Pedro Almodovar, Tim Walker, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch, Joanna Hogg, Apichatpong Weerasethakul, et Olivier Saillard – à découvrir au Eye Filmmuseum, du 28 septembre 2025 au 8 février 2026.
"Ce qui me touche le plus chez Azzedine, c'est l'histoire de ce garçon de Tunis, d'un milieu très pauvre, qui a accumulé une collection de 20 000 pièces sur l'histoire de la mode. Aucun autre créateur n'a eu un tel égard pour sa propre discipline."
Une autre relation fondée sur le temps long, sur la confiance et sur l’admiration réciproque : celle qu’il a entretenue avec Azzedine Alaïa. Olivier Saillard le rencontre dès le début de sa carrière, en 1992, alors qu'il est directeur du Musée de la Mode de Marseille et que le couturier est Président d'honneur. Ils ne se quitteront plus. En septembre 2014, alors président du Palais Galliera, Olivier Saillard lui consacre une rétrospective à la réouverture du musée après quatre ans de rénovation. "On était devenu vraiment proche et ça ne lui a pas plu que je quitte Galliera. Il m'avait dit que si je partais, je devais lui rendre les robes qu'il avait donné. Je lui ai expliqué qu'il les avait donné au musée, pas à moi !" Je venais de rejoindre Weston et il était un peu fâché. Il me disait 'Va t'amuser chez Weston, on verra plus tard.'"
Olivier Saillard est aujourd'hui directeur de la Fondation Azzedine Alaïa et Carla Sozzani en est la présidente. L'historien-auteur-institutionnel-performeur et la styliste-éditrice-galeriste-esthète (les gens brillants ont-ils nécessairement plusieurs casquettes?) sont les gardiens de la mémoire du couturier. Carla Sozzani l'a épaulé toute sa vie, même dans les moments les plus difficiles. "Entre 1992 et 2003, Azzedine a traversé un désert. Il a perdu des gens, dont sa sœur. Il a failli mettre la clé sous la porte. Si Carla n'était pas venue, tout aurait été vendu., explique-t-il. C'est elle qui l'a présenté au groupe Prada qui a investi dans la Maison puis à Richemont. Elle l'a remis au travail." La Fondation consacrera par ailleurs une exposition dédiée à la collection Printemps-Eté 2003 du couturier en septembre 2025. Cette saison où le couturier a approfondi encore davantage sa vision de l'élégance. "En 2003, la féminité qu'entretenait Azzedine, c'est-à-dire ces filles dans des bustiers avec des talons hauts, n'était plus. Il a présenté ce qu'il savait le mieux faire, à la Vionnet : des robes fluides, des robes enroulées avec des talons plats. Un peu comme s'il était passé de Los Angeles à Rome. C'est de la très, très haute couture."
Lorsqu'Azzedine Alaïa décède, le 18 novembre 2017, Carla Sozzani appelle Olivier Saillard. "Azzedine avait laissé une note. Il avait listé des noms pour diriger la Fondation.Et mon nom y apparaissait. Ca m’a infiniment touché. Et c'est pour ça que ce n'est pas un vrai travail ici. C'est comme si Azzedine m'avait remis face à ma passion." Azzedine Alaïa a laissé une collection digne des archives de musée qu'a dirigé Olivier Saillard toute sa carrière. Peut-être aussi pour cela, en plus de leur amitié, qu'il était le bon candidat. "On a des costumes de Matisse, 900 robes de Grès, 700 de Dior, 500 de Balenciaga, 300 de Vionnet. Le seul qui ai fait ça, c'est ce petit mec arrivé à Paris. Ça me touche beaucoup." Lui aussi s'est vautré dans les vêtements du passé. Pour leur qualité créative, leurs matières, leur beauté. Le même regard qu'un autre petit garçon dans un grenier à la recherche de l'émotion que seuls les vêtements du passé recèlent.
Aujourd'hui, cela fait sept ans qu'Olivier Saillard scrute le travail du couturier avec une admiration et une amitié sincères qui lui évitent toute complaisance. "Je m'interdis de faire d'Azzedine une statue équestre. Même les gens qui ont un peu souffert vous racontent parfois que c'était le plus beau des personnages. Tous les créateurs sont parfois des despotes et Azzedine était assez adorable despote. Je veux vraiment parler de son travail et de sa personnalité." Entre autres, il y a bien sûr consacré une exposition à Madame Grès, à qui il consacrait également un livre publié en mai 2025. "Je trouve qu'elle n'a pas eu la place qu'elle doit avoir, qu'elle est en attente d'avoir. Je pourrais tenir le même discours sur Jeanne Lanvin. Un grand, grand, grand talent."
Se retourner sur les pièces du passé, ne serait-ce pas le sens littéral "d'aller de l'avant" ? Ne devrait-on d'ailleurs pas dire "aller de l'après" ? Vers l'avant-garde(-robe). Petit rond de jambe en fin d'un long portrait, tâche difficile d'écrire sur celui qui écrit, avec rigueur, culture et enthousiasme, toujours un sourire en coin derrière chaque phrase.
Reuben Attia